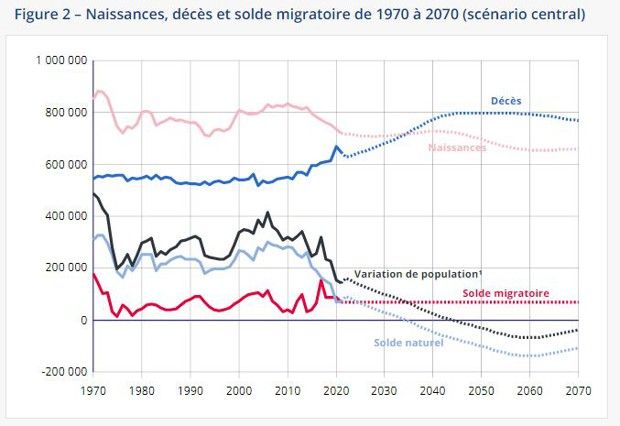Les dernières décennies ont été marquées par une recrudescence importante de l’« eutrophisation » ; on peut comparer ce phénomène à une forme d’indigestion des écosystèmes marins, gavés de quantités excessives d’azote et de phosphore.
Dans le sillage de nombreuses activités humaines (industrielles, agricoles ou domestiques), ces nutriments, utilisés en particulier comme engrais pour les cultures, sont en effet déversés dans les cours d’eau et les nappes phréatiques ; ils progressent ensuite vers le milieu marin.
Cette arrivée en masse de nutriments se traduit par le développement de végétaux, comme les macroalgues de type algues vertes ou de microalgues de type phytoplancton, qui peuvent être nuisibles ou toxiques.
Cette prolifération végétale tous azimuts peut provoquer en particulier une diminution de la concentration en oxygène dans l’eau et des changements de biodiversité conduisant ainsi à un état écologique dégradé, avec une modification de la structure et du fonctionnement des écosystèmes concernés.
Une alimentation équilibrée, le secret de santé du phytoplancton
Le plancton végétal (ou phytoplancton) est responsable de la production de la moitié de l’oxygène sur Terre. Il est à l’origine de la vie dans les mers et les océans. Il contribue aussi à absorber le dioxyde de carbone, réduisant ainsi l’effet de serre.
Premier maillon de la chaîne alimentaire en milieu marin, le phytoplancton doit lui aussi s’astreindre à un régime alimentaire équilibré. À l’instar de nos « cinq fruits et légumes par jour » préconisés chez les humains, il doit se nourrir d’un duo ou d’un trio de nutriments – phosphate, nitrate (pour tous) et silice (pour les organismes dits siliceux) – mais en « portions » bien précises.
S’il « mange » trop de l’un ou trop de l’autre, sa composition change et c’est tout l’écosystème marin qui s’en trouve perturbé.
Croissance vertigineuse
Si le phénomène de l’eutrophisation peut être d’origine naturelle – il se produit alors à des échelles de temps longues, géologiques –, la révolution industrielle, la croissance démographique et la concentration urbaine, sans oublier le développement de modèles d’agriculture plus intensive ont conduit à une eutrophisation dite « anthropique » qui se produit sur des échelles de temps (trop) courtes.
Aujourd’hui, on considère que les flux sortants à la mer ont quasiment doublé au cours du XXᵉ siècle aussi bien pour l’azote que pour le phosphore.
Au niveau mondial, le nombre et l’emprise des zones marines très pauvres en oxygène ont triplé depuis les années 1960. Un recensement de 2010 les porte à près de 500 avec une emprise géographique de 245 000 km2.
Parallèlement, on observe une augmentation de la diversité, de la fréquence, de l’importance et de l’extension géographique des proliférations de microalgues toxiques ces dernières décennies.
La reconquête de l’eau, une priorité publique
Lutter contre l’eutrophisation est donc une priorité pour la reconquête de la qualité des eaux côtières qui, avec les zones estuariennes, sont les environnements les plus productifs au monde. Environ 26 % de la biomasse végétale y prend place, alors que la surface de ces zones ne représente que 8 % de la surface de la Terre.
Ainsi, les effets de l’eutrophisation sont particulièrement marqués dans ces lieux, ce qui n’exclut pas des effets directs et indirects sur les zones plus au large.
Cette lutte contre l’eutrophisation constitue l’un des combats à l’échelle européenne de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) qui vise à maintenir ou à restaurer le fonctionnement des écosystèmes pour parvenir au bon état écologique des eaux marines.
Missionnées dans ce cadre pour fournir son expertise scientifique, les équipes de recherche de l’Ifremer dressent tous les 6 ans une évaluation de l’état des eaux en matière d’eutrophisation.
Un nouveau baromètre pour pister l’eutrophisation
Dans le dernier rapport d’évaluation DCSMM (2018) remis à l’Europe, nous avons utilisé le modèle EcoMARS3D qui a la particularité de coupler modèles biologique et physique, tout en nous appuyant sur les données in situ, mais aussi les produits dérivés des images satellites.
Ces approches multiples participent à affiner notre diagnostic.
Si les données in situ ont l’avantage d’être très fiables, elles demeurent parcellaires. Afin d’améliorer leur résolution spatiale et temporelle, une solution consiste à les compléter grâce à des informations provenant de capteurs installés sur des satellites (on parle alors de l’observation de la couleur de l’eau) et grâce à la modélisation.
La combinaison de ces différentes sources d’informations permet de définir un seuil de chlorophylle-a – indice-clé pour évaluer le risque d’eutrophisation que l’on déduit en cartographiant le plancton – à ne pas dépasser afin d’être compatible avec le bon état écologique, puis de définir la concentration de nutriments en mer qui y correspond.
À partir de cette concentration en mer, il est alors possible d’évaluer le flux de nutriments maximal acceptable en provenance du bassin versant.
Cette modélisation, réalisée en collaboration avec le consultant en ingénierie Actimar, permet de proposer des scénarios de réduction des apports de nutriments dans les cours d’eau afin d’aider à la prise de décision quant aux mesures à engager pour réduire l’eutrophisation.
De moins 80 % à moins 10 % de réduction de nutriments nécessaire
En s’appuyant sur ce nouveau modèle et en étant conscient de toutes les limitations qu’implique une telle approche, nous avons esquissé des scénarios spécifiques pour 45 fleuves représentatifs des principales sources de nutriments en France
L’objectif : calculer le taux de réduction en nutriments nécessaire afin de se rapprocher du « bon état écologique » au regard des critères définis par la Directive-cadre sur l’eau (DCE) et la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM). Ce « bon état » des eaux marines désigne le bon fonctionnement des écosystèmes, au niveau biologique, physique, chimique et sanitaire, permettant un usage durable du milieu marin.
Les résultats obtenus montrent que pour ramener la façade Manche-Atlantique au-dessous des seuils de très bon état et bon état pour le nitrate, les apports des principaux fleuves – Garonne, Dordogne, Loire et Seine – doivent être réduits drastiquement : à savoir plus de 60 % pour le bon état et plus de 80 % pour le très bon état.
Certains petits fleuves côtiers (Bresle, Arques, Yar-Douron, Haute-Perche, Falleron, Sallertaine, Vie, Seudre) peuvent se contenter d’un abattement limité, voire nul car les activités susceptibles de contribuer aux apports des nutriments sont plus faibles sur les bassins versants concernés.
S’agissant du phosphore, les abattements préconisés sont plus faibles, entre 10 et 20 % pour les principaux fleuves, excepté la Seine qui avoisine les 60 %. Ce phénomène s’explique par des mesures de déphosphatation appliquées plus précocement et à une dynamique différente de ces nutriments, plus facile à limiter que l’azote.
Quant à la Méditerranée, son caractère de mer « oligotrophe », très pauvre en nutriments, la préserve d’une eutrophisation massive. Cette mer fermée reçoit en effet moins d’apports en nutriments que les autres façades maritimes françaises. Ses deux principales sources de nutriments sont les eaux de surface de l’Atlantique provenant du détroit de Gibraltar et le Rhône. Les problèmes restent de ce fait très ponctuels et cantonnés autour de l’embouchure du fleuve.
Une régénération possible (mais lente)
Ces chiffres marquent l’étendue des efforts à accomplir pour limiter l’eutrophisation côtière, mais attestent aussi de progrès sensibles grâce notamment à une diminution de la présence de phosphates dans l’eau.
Sur ce plan, la stratégie consistant à éliminer les phosphates des lessives avec une interdiction de vente prononcée en France dès 2007 a porté ses fruits. Du côté des nitrates, une amélioration a pu être constatée, mais le défi reste maintenant de parvenir à mieux juguler les apports azotés diffus liés au ruissellement, de la terre vers la mer.
Même si on coupait tous les robinets d’apports de nutriments dans les cours d’eau en même temps, la situation ne s’améliorerait pas instantanément. Il faut avoir conscience que, face au phénomène d’eutrophisation, le temps de régénération des écosystèmes est long – les nutriments emprisonnés dans les nappes et les sédiments sont par exemple relargués avec un effet retard.
La modélisation, une aide précieuse
D’où la nécessité de ne pas baisser la garde devant cette prolifération végétale galopante qui n’est pas qu’un problème français et se révèle une source de préoccupation à l’échelle mondiale.
En tant que scientifiques, nous visons à améliorer constamment les connaissances sur ces phénomènes pour offrir – comme avec le modèle EcoMARS3D – des outils précieux d’aide à la décision. Nous poursuivons notre travail de modélisation pour le rendre encore plus efficient à l’horizon 2024, date de la prochaine évaluation de la DCSMM.
Parallèlement, dans le cadre de la convention OSPAR pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, nous optimisons aussi des outils de modélisation pour définir cette fois les seuils aval à ne pas dépasser afin de faire cap sur une amélioration de la qualité des eaux à l’échelle de l’Atlantique nord-est.
D’amont en aval, la boucle est bouclée pour mieux circonscrire la croissance d’un plancton devenu parfois indésirable alors qu’il est source de vie.