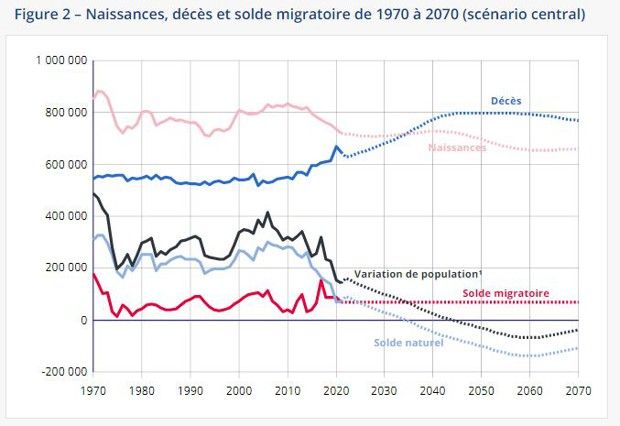Vous avez souvent la migraine ? Il est possible que cela soit dû à certains facteurs de votre environnement – des facteurs que vous pouvez heureusement contrôler pour réduire la fréquence ou le niveau de la douleur.
Tout d’abord, la migraine ne se limite pas à un simple mal de tête. Elle peut également affaiblir votre organisme, vous rendre sensible à la lumière et au bruit, affecter votre vision et globalement vous donner l'impression qu’on vous cogne la tête avec un marteau. Et dans ces cas-là, il n'y a rien à faire, sinon fermer les yeux et prier pour que ça s'arrête. Selon l'American Migraine Foundation, il s'agit d'un trouble neurologique, qui peut se manifester sous une forme très intense (qui comprend des symptômes comme les nausées, les vertiges et les douleurs) et qui peut durer entre 4 et 72 heures.
Selon une étude publiée dans la revue Headache, environ 16 % des adultes souffrent de migraine et, bien qu’ils ressentent tous des symptômes similaires, les facteurs qui déclenchent ou aggravent leurs maux de tête peuvent être différents pour chacun.
Qu'est-ce qui provoque une migraine ?
Il est important de comprendre ce qui déclenche vos migraines, car cela peut vous aider à les prévenir ou à les réduire. Les experts ne savent pas exactement quelle en est l’origine, mais ils ont identifié un certain nombre de facteurs qui peuvent déclencher ou aggraver la douleur.
Que faire si l'un de ces facteurs vous affecte ? Il est recommandé de contrôler son niveau de stress, de bien dormir, de surveiller son alimentation et, en cas de migraine intense, de se reposer, de prendre un médicament contre la douleur (un, pas trois !), de s'éloigner des écrans ou même de pratiquer la méditation pour se détendre.
Le fait de sauter des repas ou d’avoir un trop faible apport en calories peut faire chuter le taux de sucre dans le sang et, selon la National Headache Foundation, cela peut entraîner des troubles qui vont du mal de tête tenace à la migraine intense : c'est pourquoi il est essentiel de surveiller votre alimentation.
La déshydratation n'affecte pas seulement votre apparence : selon plusieurs études, elle peut aggraver de nombreux problèmes de santé, à commencer par l’intensité des maux de tête et des migraines.
Selon l'Anxiety and Depression Association of America, le stress, l’inquiétude ou l’anxiété peuvent entraîner des migraines plus fréquentes et plus graves (le stress est identifié comme facteur déclencheur pour 70 % des patients migraineux). On ne sait pas exactement pourquoi, mais il semble y avoir un lien évident entre ces différentes réactions.
Vous avez l'impression de pouvoir prédire la météo grâce à vos maux de tête ? L'American Headache Society indique que les changements brusques d'humidité, de température et de pression ont également un effet sur la migraine, car ils ont tendance à amplifier la douleur.
Là où choses se compliquent un peu, c’est que l'American Migraine Foundation affirme que l’activité physique peut à la fois déclencher et traiter les migraines. L'exercice régulier aide à réduire la fréquence des migraines, à diminuer le stress et à mieux dormir, mais il a également été démontré qu’il peut déclencher des migraines chez certaines personnes, probablement parce qu'il entraîne une augmentation de la pression sanguine, ce qui affecte les nerfs du cerveau.
Les allergies au pollen, à la poussière ou à l'herbe, pour n’en citer que quelques-unes, peuvent provoquer des éternuements, mais aussi augmenter la fréquence des migraines pendant la saison.
Les lumières intenses, les odeurs fortes et les environnements bruyants peuvent provoquer des maux de tête et des migraines. Certains patients rapportent également des symptômes visuels comme des flashs lumineux.
Tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires et, bien que les antalgiques soient souvent recommandés dans le traitement de la migraine, ils peuvent aussi favoriser son apparition en cas de surconsommation.
Le bruxisme se traduit par une mâchoire tendue et un grincement involontaire des dents. Selon la Mayo Clinic, ce trouble exerce un stress sur les articulations de la mâchoire, ce qui peut entraîner une augmentation des douleurs à la tête et dans la nuque.
La qualité du sommeil joue un plus grand rôle que vous ne le pensez. Si vous ne dormez pas assez ou si, au contraire, vous dormez trop, cela va provoquer un dérèglement de votre rythme circadien (ou horloge biologique, si vous préférez) et aggraver vos migraines.